| |
Notes biographiques et résumés des présentations
| |
|

Professeur Noukpo N.
AGOSSOU, Ph.D.
Ex-directeur du département de géographie de l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin. |
Notice biographique
Ancien professeur certifié des lycées & collèges du Bénin, ex réfugié politique au Canada; est géographe spécialiste d’organisation régionale & développement économique. Maître de conférences habilité à diriger des recherches, ancien chef du Département de Géographie et Aménagement du Territoire de l’UAC. Directeur du Laboratoire d’Aménagement Régional & Développement (LARD). A d’abord enseigné trois années (1987 – 1990) à l’Université Laval, avant de retourner au Bénin où il enseigne la géographie régionale, la méthode géographique, les activités économiques informelles en Afrique de l’Ouest, le développement économique, etc. aux Universités d’Abomey-Calavi et Porto-Novo. Invité à l’Université d’Aix-Marseille-1 chaque année pour un mois d’enseignement et de recherche de 2002 à 2007. Auteur de plusieurs articles parus dans : Recherches Géographiques à Strasbourg, Éducation Béninoise, Cahiers de Géographie du Québec, Revue de Géographie du Cameroun, L’Espace Géographique, Autrepart, Géographie et Cultures, BenGéo, Annales de la FLASH, Cybergéo, etc. Co-directeur du volume 9 Systèmes spatiaux et structures régionales en Afrique de la collection Maîtrise de l’espace et développement en Afrique dirigée par J. Igué aux éditions Karthala, 2010.
Très engagé socialement. A écrit une autobiographie intitulée : Évadé des prisons de K parue chez CAAREC Éditions en 2008 dans la collection Témoignages.
Résumé de la présentation
Vitalité, problématique et perspectives de la géographie béninoise
La géographie béninoise est en marche. Au cours des dernières années les recherches menées par les géographes béninois ont pris une grande ampleur. Suivant des directions variées en fonction des préférences personnelles et des intentions de chacun (recherche fondamentale ou recherche appliquée, travaux individuels ou études collectives, etc.). À travers la masse considérable des publications apparaissent un certain nombre de thèmes généraux fédérateurs. Sans nier la dose inévitable d’arbitraire que tout classement comporte, il paraît utile de présenter sous une forme condensée un bilan nécessairement sommaire (vu les contraintes imposées par la présente communication) de la géographie béninoise à travers le dépouillement des diverses œuvres des géographes béninois.
Par ailleurs l’engouement pour les études géographiques universitaires est très forte comme l’atteste la progression des effectifs étudiants inscrits au Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT) de l’Université d’Abomey-Calavi. Cette croissance exponentielle (moins de 1 000 étudiants jusqu’en 2000, plus de 9 000 en 2010) ne manque pas de poser de sérieux problèmes de gestion, de pénurie de toutes sortes, de la qualité des formations, etc.
Après avoir étudié les principaux sujets objet de la recherche géographique au Bénin, l’article aborde les perspectives qui s’offrent à la géographie béninoise dans les années à venir. |
| |
|

Professeur Amor
BELHEDI, Docteur d'État
Ex-directeur du département de géographie de l'Université de Tunis, Tunisie |
Notice biographique
Géographe, (01-01-1950, né à Souk Lahad, Tunisie), Professeur au Département de Géographie, Faculté des Sciences Humaines & Sociales, Université de Tunis depuis 1978 après avoir travaillé au District de Tunis (Agence d’Urbanisme du Grand Tunis) entre 1975-1978.
Après la Maîtrise de Géographie en 1974, la thèse de doctorat de 3° cycle 1977 a porté sur « Transport et organisation de l'espace : Chemin de fer et espace en Tunisie » et a été publiée en 1980, la thèse d’Etat 1989 a porté sur « Espace et société en Tunisie : Développement, aménagement et organisation de l'espace en Tunisie » et a été publié en 1992.
Participation à de nombreuses études relatives à la planification urbaine, le développement et l’aménagement régional, le développement rural, la migration dans le cadre d’études menées à l’échelle nationale (Migration et développement régional, l’aménagement régional, développement rural, enfance, ) et internationale (Pnud : planification régionale, tourisme, CEE : Migration).
Les recherches actuelles portent essentiellement sur l’organisation spatiale, le développement territorial, l’épistémologie et les méthodes d’analyse en géographie.
Membre du comité éditorial de la Revue Tunisienne de Géographie depuis le début des années 1980, Rédacteur en chef puis Directeur de la Revue (2000-2006 et depuis 2010) et membre correspondant ou du Comité éditorial de plusieurs revues en Tunisie et en France (Espace Géographique, Cybergeo, cahiers du Gremamo).
Auteur de huit ouvrages, coordinateur de 2 livres et participation à 4 ouvrages, 4 études et 4 rapports. Auteur de plus d’une centaine d’articles publiés dans de nombreuses revues en Tunisie et à l’étranger. Encadrement de plusieurs chercheurs en géographie au niveau du DEA, DESS, Master, Doctorat 3° cycle, Doctorat et Doctorat d’Etat.
Résumé de la présentation
Pour une géographie citoyenne
La géographie connaît un sort différent selon les aires et les pays en fonction défis et des problèmes qu’affrontent les différents pays et les divers territoires. Si elle constitue une discipline de la connaissance en sursis dans certains pays, en crise ou en progrès dans d’autres cieux. Elle est cependant partout, appelée à jouer un rôle de premier ordre. Loin de se réduire aux aspects techniques et aux outils d’analyse comme la CAO, la télédétection ou les SIG, la géographie doit se munir d’une problématique de pertinence et de réponse à une demande sociale. Elle peut s’atteler à atteindre quatre objectifs essentiels au moins :
D’abord, elle constitue une discipline de connaissance des espaces et des territoires qui traite la production spatiale et territoriale afin de comprendre le rôle de l’espace dans la vie de l’individu et des groupes sociaux. On peut considérer la géographie, beaucoup plus qu’un espace de la synthèse comme elle a été souvent considérée ou conçue, comme la discipline de la synthèse de l’espace et du territoire.
En second lieu, la géographie doit traiter des problèmes du développement territorial, de la re-construction et de la re-composition territoriales dans les pays moins avancés (pays sous développés et en voie de développement parallèlement à la tâche de combat : de la bonne guerre, de la paie et du progrès à la fois.
Ensuite, dans les pays avancés notamment mais aussi dans les autres pays, la géographie doit traiter de la géo-gouvernance qui consiste à assurer la gouvernance territoriale des territoires et des géosystèmes.
Enfin, la géographie constitue aussi une discipline qui permet d’atteindre la démocratie à travers une géographie citoyenne au service du développement durable.
Ces quatre objectifs réunis nécessitent une recomposition disciplinaire et un recentrage des problématiques pour rendre à la géographie la place qui lui revient pour être une discipline de la connaissance et de l’action à la fois au service du citoyen. |
| |
|

Professeur Vincent BERDOULAY, Ph.D.
Département de géographie de l'Université de Pau et des pays de l'Adour, France. Membre du Comité de pilotage de la Commission Approches culturelles de la Géographie, Union géographique internationale (UGI).
|
Notice biographique
Vincent Berdoulay, après avoir obtenu un doctorat de l’Université de Californie-Berkeley et fait un post-doctorat à l’Université d’Etat de l’Ohio (O.S.U.), a exercé comme professeur à l’Université d’Ottawa de 1975 à 1989. Il est actuellement professeur de géographie et aménagement à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, où il est membre du Laboratoire SET (Société, Environnement, Territoire) du CNRS. Il est actif au sein des commissions de l’Union Géographique Internationale (Approche culturelle de la géographie, Histoire de la géographie) et, de façon plus générale, dans la coopération scientifique internationale. Ses travaux portent principalement sur l’histoire et l’épistémologie de la géographie, la géographie culturelle, les enjeux écologiques, environnementaux et patrimoniaux, l’aménagement et l’urbanisme.
Résumé de la présentation
Crise de la modernité ou crise de la géographie?
La perspective du temps long
Pour évaluer les difficultés actuelles que connaît la discipline de la géographie, plus ou moins profondes selon les pays, il est nécessaire de les replacer dans la perspective du temps long. C’est celle-ci qui permet de mieux faire la part entre ce qui est circonstanciel, structurel, nouveau, ou non, dans les relations que la géographie entretient avec son contexte sociétal, et ainsi de mieux réfléchir aux actions à prendre pour remédier à des situations difficiles ou pour développer acquis et succès.
La communication partira de quelques éléments du diagnostic qui est fait maintenant sur la situation de la géographie. On verra que la crise actuelle reprend, à bien des égards, des problématiques récurrentes. Surtout, il semble que les plus significatives d’entre elles renvoient au devenir de la modernité et à ses multiples crises.
Se replacer dans le temps long permet aussi d’analyser, à la lumière de ces crises, comment ont pu s’articuler ce qui apparaît comme trois grands piliers de la pensée géographique, trois grands horizons de l’activité qu’elle engendre. Il s’agit des langages formels, de la narrativité et de l’imaginaire. Le potentiel de leur combinaison est immense, comme le montre l’évolution de la pensée géographique.
Il est alors possible de revisiter les interrelations de la géographie et de la modernité. On constate que la modernité n’est pas une, mais plurielle, et que cette pluralité correspond à des divergences sur l’importance et la conception de la géographie. La crise actuelle est une opportunité, non pour se conformer à un discours dominant, mais pour développer des thèmes propres à répondre à des demandes profondes de la société. Quelques exemples, et notamment celui de l’aspiration à la reconnaissance de l’individu-sujet, seront évoqués à partir de recherches actuelles. |
| |
|

M. Pierre BONIN, géographe
Ex-responsable pour l'Afrique et le Moyen-Orient à la direction des programmes de coopération du SUCO.
Membre d'Amitiés Canada-Rwanda |
Notice biographique :
Travailleur autonome et membre actif au sein du mouvement québécois de solidarité internationale depuis la fin des années cinquante. Géographe et éducateur spécialisé en développement, il a enseigné dans plusieurs universités au Québec et au Rwanda. D’abord analyste des sociétés paysannes et des écosystèmes ruraux du Québec et du Rwanda, il travaillera par la suite au développement local et régional, à la promotion des droits humains et au renforcement des organisations de la société civile, particulièrement au Mali et en Haïti. Il a œuvré comme enseignant, puis au service d’ONG québécoises et canadiennes, maliennes et haïtiennes, mais aussi avec l’ACDI, l’OÉA, le PNUD et la Mission civile des droits de l’homme en Haïti, un pays avec lequel il poursuit ses engagements sociaux. Il participe au comité des droits des personnes migrantes et réfugiées de la Ligue des droits et libertés. Ses rapports avec le Rwanda et le Rwandais datent de 1964 où il a séjourné trois ans. Par la suite, il a effectué dans ce pays un grand nombre de mission d’étude, planification, suivi et évaluation de projets ruraux, missions qui l’ont amené à visiter toutes les communes de ce pays. Depuis la fin des années ’80, il collabore avec des Rwandais établis au Québec au sein de l’association Amitiés Canada-Rwanda, successivement sur un projet Radio-jeunesse puis sur l’organisation de stages jeunesse au Québec et au Mali avec le concours de Québec sans frontières. En août 2010, ACR présentait au grand public dans le hall d’honneur de l’l’hôtel de Ville de Montréal la première édition d’une exposition intitulée « Rwanda – Pays des mille collines », réalisation collective dont il est le concepteur. |
| |
|

Professeur Marc BROSSEAU, Ph.D.
Directeur du département de géographie de l'Université d'Ottawa |
Résumé de la présentation
Qu’advient-il de la géographie? : perspectives ontariennes.
Les développements des rapports que la géographie entretient avec la société ont de quoi en inquiéter plusieurs. Diminution de sa présence dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire, tendance techniciste la réduisant à ses dimensions instrumentales (SIG, télédétection etc.), absence relative de reconnaissance du statut de géographe auprès des employeurs ne sont que certains des indicateurs de sa valeur relative dans le marché des savoirs. Pourtant, plus que jamais dans l’histoire récente de la discipline, le savoir géographique et ses concepts de prédilection font l’objet d’emprunts de plus en plus nombreux de la part de plusieurs autres sciences humaines et sociales. À la lumière d’un examen de l’évolution des tendances au Département de géographie à l’Université d’Ottawa (demandes et inscriptions dans les différents programmes) et des emplois occupés par les diplômés récents des trois cycles, le diagnostic posé par les organisateurs du colloque a peut-être lieu d’être nuancé. En dépit de la perception selon laquelle la « géographie, ça sert, aujourd’hui, à faire, de belles cartes », quelques éléments de réflexion tenteront de montrer la pertinence contemporaine d’un esprit géographique pour comprendre la monde et faire face aux défis de la société. |
| |
|

M. Yannick BRUN-PICARD, Ph.D.
Chercheur indépendant |
Notice biographique :
Au cours de sa première vie professionnelle a porté un intérêt soutenu à l’histoire militaire et plus particulièrement aux troupes coloniales, à la force Noire, aux unités françaises qui ont été blanchies à l’issue de la seconde guerre mondiale. La place des violences, des dynamiques des violences et les territorialisations qui en résultaient commençait à émerger. L’orientation se fit, alors, en direction de la géographie sans pour cela délaisser l’histoire et plus particulièrement l’épistémologie. Sa thèse : L’humanisme géographique (2005), atteste de ce lien ténu entre ces domaines de la connaissance.
Depuis plusieurs années les thèmes d’études récurrents portent sur les dynamiques territoriales de la prostitution périurbaine, les territorialités des violences, les violences scolaires sans omettre la formation pour adulte, ou andragogie, qui fut son domaine d’exercice pendant deux décennies. Ainsi, sont associés des domaines des sciences humaines parfois antagonistes qui toutefois permettent de décrypter les dynamiques des territorialisations induites.
Quelques-uns des ses articles inédits sont accessibles sur un blog qui le soutient : géosociologie-over-blog.com.
Actuellement œuvre à l’écriture d’un ouvrage sur les violences scolaires et leurs territorialités. Sa définition de la géosociologie, perfectible, donne le cadre général des ses domaines de recherches qui mettent en perspective l’objet de la géographie : l’interface humanité/espaces terrestres.
Résumé de la présentation
La géographie : un verre à moitié vide ?
Cette communication à pour objectif de mettre en exergue le verre à moitié vide de la géographie. C’est-à-dire aller à l’encontre de la quasi-totalité du monde des géographes. Si un colloque porte pour intitulé : « qu’advient-il de la géographie ? », c’est que des inquiétudes existent au sujet de la géographie et que celles-ci trouvent leur source dans les ombres de ce domaine scientifique.
Qu’est-ce qui fait que les géographes donnent l’impression de ne pas savoir, concevoir et projeter ce qu’il advient, ce qui peut advenir de la géographie ? Développer, à charge, un argumentaire met en porte-à-faux l’auteur. Toutefois, malgré cet handicap et les foudres auxquelles seront exposés les observations, il semble responsable d’accepter et d’aborder ce coté obscur.
De nombreux auteurs se sont penchés sur ce qu’est la géographie, leurs propositions sont les bases à notre démarche critique. Ainsi, nous avons accès à ce que semble être la géographie contemporaine. Des errances, des satisfécits et des fourvoiements existent au cœur de cette science. Ils nuisent à la géographie en tant que domaine scientifique. Les causes, les mécanismes et autres dynamiques de la situation en devenir deviennent perceptibles. Cet ensemble mène à « l’insupportable proposition ».
Les regards et les analyses critiques sont trop rares sans pour cela brûler ce qui nous a fait. Seules des actions fondées, fouillées et projectives, sont à même d’engendrer, en toute responsabilité, des approches vectrices de dynamiques porteuses pour la géographie.
Mots clef : géographie, transdisciplinarité, science, critique, responsabilité. |
| |
|

Professeur (ret.) Luc BUREAU, Ph.D.
Université Laval, Québec |
Notice biographique
C’est à l’université Laval que Luc Bureau entreprend en 1965 des études en géographie, y complétant une licence et une maîtrise dans cette discipline. En 1973, l’université du Minnesota (Minneapolis) lui confère le titre de Doctor of Philosophy. De 1971 à 2001, il enseigne la géographie au Département de géographie de l’université Laval. Mis à part des articles publiés dans diverses revues et des ouvrages faits en collaboration, il est l’auteur d’essais : « Entre l’Éden et l’Utopie : les fondements de l’imaginaire québécois » (1984); « La Terre et Moi » (1991); « Géographie de la nuit » (1997); « L’Idiosphère : De Babel au Village universel » (2001); « Terra Erotica » (2009); « Il faut me prendre aux maux » (2010); et de deux grandes anthologies géo-littéraires : « Pays et mensonges » (1999) et « Mots d’ailleurs » (2004).
Résumé de la présentation
La géographie à cour… de mots
L’expression interrogative « Qu’advient-il? » est une interpellation angoissée, traduisant une incertitude, une inquiétude, tout au moins une préoccupation quant à l’état ou au devenir de quelqu’un ou de quelque chose. « Qu’advient-il du manuscrit que je vous ai adressé il y a plusieurs mois? » s’impatiente l’auteur devant un éditeur tortionnaire. « Qu’advient-il des avoirs de Jean-Claude Duvalier? » s’inquiète un fonctionnaire du Trésor public. « Qu’advient-il des églises du Québec? » se désolent quelques adeptes du patrimoine religieux. Le : « Qu’advient-il de la géographie? » se situe dans le même courant d’agitation ou d’appréhension. L’objet géographique serait-il achevé, défunt, ou en état de déliquescence? Les figures de la terre seraient-elles un sujet clos, épuisé, fermé? Si une telle situation existe, c’est peut-être que la géographie a oublié ce qu’elle était : geo (terre) et graphein (écrire, décrire, raconter, coucher sur le papier…). Le géographe tire la terre du néant par des mots; il crée des régions, des rivières, des villages, des montagnes, des banlieues par des mots. Ce géographe créateur aurait-il contracté le virus de l’aphasie? Ce vide aphasique peut-il être comblé? |
| |
|

M. Yann CALBÉRAC, Ph.D.
Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à l'IUMF de Paris, Université Paris-Sorbonne, France |
À VENIR |
| |
|

Brigadier-général Gerry CHAMPAGNE
Forces armées canadiennes |
Notice biographique
COMMANDANT ADJOINT DE COMMANDEMENT DU CANADA
Le Brigadier-général Gerry Champagne obtient son brevet d'officier et joint le Royal 22e Régiment en 1977. Au cours de sa carrière au 2e Bataillon R22R à Québec et au 1er Bataillon R22R en Allemagne, il a le privilège de commander un peloton d'infanterie et d'œuvrer aux postes de commandant adjoint du peloton de reconnaissance et d'officier des renseignements.
En 1982, à sa première mutation à l'École d'infanterie, il est employé comme commandant de cours sur les cours en leadership et commandant adjoint de la compagnie des tactiques et chef des normes. Il retourne en 1988 au 1 R22R où il commande pendant deux ans une compagnie d'infanterie mécanisée. À titre de commandant adjoint du 2 R22R et de commandant des forces de l'ONU dans l'enclave de Srebrenica, il a l'occasion de se déployer en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de l'opération Cavalier en 1993, au sein du Bataillon canadien (CANBAT) 2. Par la suite, en 1995, il est en déploiement en Croatie lors de l'opération Harmony, à nouveau comme commandant adjoint du CANBAT 4. De juin 1995 à juillet 1998, le Brigadier-général Champagne commande l'École d'infanterie, soit le centre d'excellence du Corps d'infanterie. Il a aussi le privilège d'être le commandant du 5e Groupe de soutien de secteur, à Montréal, de 2006 à 2008.
Le Brigadier-général Champagne a occupé de nombreux postes d'état-major. En 1984, il est nommé gérant de carrières pour les officiers subalternes du Corps d'infanterie. Il travaille successivement comme officier d'état-major du chef de la doctrine et des opérations de terre en 1991, à titre d'adjoint exécutif au Sous-chef de la défense de terre chargé des renseignements, de la sécurité et des opérations en 1992 et comme adjoint exécutif au Sous-chef de la Défense nationale en 1993. Entre 1998 et 2001, il occupe le poste de directeur de groupe d'étude au Collège de commandement et d'état-major de la Force terrestre. De 2003 à 2005, il est nommé directeur de la disponibilité opérationnelle de la Force terrestre (G3 Armée de terre). En 2008 et 2009, il agit à titre de directeur Opérations courantes et, une fois promu brigadier-général, il devient le directeur général, opérations au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa. En déploiement à Kandahar (Afghanistan) en 2009, il devient le chef d'état-major et directeur – plans futurs au quartier général du Commandement régional – Sud (RC[S]) de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS). Il a occupé à partir du 9 avril 2010 le poste de commandant adjoint de Commandement Canada.
Le Brigadier-général Champagne a suivi le cours de commandant d'équipes de combat, le cours de commandement et d'état-major de la Force terrestre 8602 le cours de commandement et d'état major des Forces canadiennes 16 et le cours militaire avancé d'état-major 02. Il a terminé sa maîtrise en Gestion de la défense et des politiques en 2003. |
| |
|
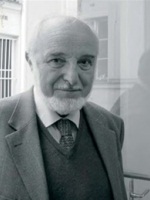
Professeur émérite Paul CLAVAL
Université de Paris-Sorbonne |
À VENIR |
| |
|

Capitaine de vaisseau
Gilles COUTURIER
Forces armées canadiennes |
Notice biographique
DIRECTEUR - STRATÉGIE MARITIME
Le capitaine de vaisseau Couturier termine ses études universitaires aux Hautes Études Commerciales de Montréal en 1986 et joint immédiatement les Forces canadiennes.
Après sa formation initiale à Esquimalt (C.-B.), l’Enseigne de vaisseau Couturier est muté à son premier navire opérationnel en décembre 1987, le Navire Canadien de Sa Majesté SKEENA, basé à Halifax. Son premier déploiement est au large des côtes de Haïti pour OPÉRATION EXCURSION.
Une fois promu au rang de lieutenant(v), il complète les cours d’officier de guerre de surface et anti-aérienne et de contrôleur aérien embarqué et retourne à bord du SKEENA pour deux déploiements de la force permanente de l’OTAN. Le lieutenant(v) Couturier est ensuite affecté à terre comme aide de camp du Commandant du Commandement Maritime à Halifax. Il retourne ensuite en mer en 1994 à titre d’officier de combat à bord du HMCS HURON. Sa prochaine affectation est au sein la Flotte Canadienne du Pacifique à Esquimalt. Durant les trois prochaines années, le capitaine de corvette Couturier aura la chance de travailler étroitement avec la marine américaine, notamment comme officier d’opération pour le groupe porte-avion du USS ABRAHAM LINCOLN pour l’exercice RIMPAC 2000.
Après avoir suivi le cours d’État-major et de Commandement des Forces Canadiennes à Toronto, le capitaine de corvette Couturier est nommé commandant en second du NCSM VILLE DE QUÉBEC en juillet 2001. Promu au grade de capitaine de frégate en décembre 2002, il est ensuite transféré au Quartier général de la défense national en juillet 2003 où il assume la position de chef de cabinet pour le Chef d’état-major de la Marine canadienne. Le capitaine de frégate Couturier a commandé la frégate NCSM FRÉDÉRICTON de décembre 2005 à juin 2007. En mai 2006, le FRÉDÉRICTON saisit 22.5 tonnes de stupéfiants destinés au marché canadien au large des côtes de l’Afrique dans le cadre de l’opération Chabanel, opération menée conjointement avec la GRC. De retour au quartier général à Ottawa, il a occupé les fonctions de chef de cabinet pour le Chef d’état major de la Défense Nationale, le général Rick Hillier. Un gradué du programme d’étude de sécurité nationale, le capitaine de vaisseau Couturier est présentement le commandant du Quatrième groupe d’opérations maritime à Esquimalt. Ses responsabilités incluent le commandement des forces maritimes pour les Olympiques de 2010 à Vancouver. |
| |
|

M. Sylvain DECELLES, M.A. et M.Ed.
Vice-président, Conseil canadien de l'enseignement de la géographie |
À VENIR |
| |
|

Professeur (ret.) Laurent DESHAIES, Ph.D.
Université du Québec à Trois-Rivières |
Résumé de la présentation
Reconnaissance et visibilité ECONNAISSANCE ET VISIBILITÉ SOCIALES ET SCIENTIFIQUES DE LA GÉOGRAPHIE : MYTHES, RÉALITÉS ET DÉFIS
La situation de la géographie québécoise semble s’être détériorée depuis une quinzaine d’années et l’évolution récente de la discipline, des sciences et des sociétés exige un retour sur cette problématique déjà ancienne et abondamment débatue. Cette fois-ci, il faut approfondir la question et éviter les écueils du passé comme, par exemple, une apologie tous azimuts des bons coups des géographes, la tentation de limiter le champ de la discipline dans des domaines spécifiques ou dans un ordre professionnel des géographes, la cristallisation du débat entre les pessimistes considérés comme des misérabilistes et les optimistes vus comme des naïfs. Pour le présent exposé, nous tenterons de faire une analyse plus poussée des problèmes de reconnaissance et de visibilité de la géographie et nous chercherons des éléments positifs pour l’avenir dans les acquis des recherches épistémologiques récentes. Pour analyser les causes du problème, il s’agit de nuancer la problématique selon les trois grandes catégories de la discipline : la géographie scolaire, l’enseignement universitaire et la géographie savante. Par ailleurs il y a aussi intérêt à considérer la nature de la contribution réelle et potentielle des connaissances géographiques dans l’univers social, soit dans les champs de la géographie professionnelle (habituellement assurée par les géographes), la géographie citoyenne (celle des acteurs dans le territoire) et la géographie médiatique portant surtout sur les débats sociaux. À la réflexion la géographie québécoise ne répond pas suffisamment aux besoins de l’approfondissement des enjeux socio territoriaux et de la résolution des problèmes sociaux. Les acquis de la réflexion épistémologique depuis une quinzaine d’années peuvent servir à diminuer l’écart entre une vision disciplinaire revisitée et les besoins sociaux. Mais les obstacles institutionnels sont quasi insurmontables. Le système actuel aura donc tendance à se reproduire avec les mêmes problèmes et culs-de-sac et à refaire les mêmes débats dans un autre colloque ayant pour question : « qu’advient-il de la géographie ? » |
| |
|

Mme Lucie DUFRESNE, Ph.D.
Géographe et écrivaine
Maison de la géographie de Montréal
|
Résumé :
De l’utilité de la formation en géographie pour appréhender l’espace à différentes échelles : des Vikings aux narcos.
La formation de géographe permet d’analyser le territoire et les usages qu’on en fait. Encore aujourd’hui, en pleine révolution technologique. L’essor des communications n’aurait pas aboli l’espace, mais au contraire, l’aurait rendu plus complexe en créant une nouvelle sphère d’interactions : le monde virtuel. Ainsi, aux échelles régionales et continentales, s’ajoute l’échelle planétaire, maintenant accessible au commun des mortels.
À travers les âges, la connaissance du territoire s’est toujours avérée un atout précieux. On peut citer des cas célèbres.
À leur époque, les Vikings maitrisaient mieux l’espace que leurs ennemis. Ayant peu de terre, leur force résidait dans la navigation. Ils avaient développé des bateaux capables d’affronter mers et rivières et de franchir les obstacles. Ils ont ainsi écumé les côtes de l’Europe, de la Méditerranée, de l’Amérique et les fleuves de Russie. Ils transportaient l’ivoire de morse, les faucons et les esclaves vers le sud d’où ils rapportaient du bois, des poissons et viandes séchées. Après leurs pillages, ils se cachaient au nord, où personne n’osait aller les chercher.
Cette même connaissance de l’espace permet aux narcotrafiquants de défier tous les systèmes policiers du monde. Ils agissent à l’échelle planétaire. Les diasporas latino-américaines les aident à écouler leurs produits au nez et à la barbe de toutes les organisations nationales. Chaque cartel est d’abord solidement enraciné dans un territoire précis, le plus souvent, quelques états ou provinces à l’intérieur d’un pays. De là, ils rayonnent en utilisant les moyens de communication les plus sophistiqués.
La géographie sert bien à faire la guerre, oui, mais aussi le trafic. |
| |
|

Mme Marie Louise ÉTÉKI OTABELA, Ph.D.
Présidente nationale de la Coordination des forces alternatives du Cameroun, Douala, Cameroun |
À VENIR |
| |
|
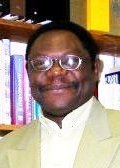
Professeur Raoul ÉTONGUÉ-MAYER, Ph.D.
Ex-directeur du département de géographie, Université Laurentienne, Sudbury, Ont. |
Notice biographique :
Raoul Étongué Mayer est professeur titulaire au département de géographie à l’Université Laurentienne de Sudbury. Il y enseigne la géographie depuis 1990. Ancien directeur du département de géographie de l’Université Laurentienne et partisan de l’unité de la géographie, il détient une licence ès lettres (Université de Yaoundé), une maîtrise ès sciences (Université de Sherbrooke) et un PhD (Université Laval). Il a, à titre de professeur visiteur, dispensé ses enseignements en Afrique (Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Maroc) et en Chine (South West University of Science and Technology, Mian Yan). Membre du comité de rédaction de International Journal of Advanced Studies and Research in Africa, Raoul Étongué Mayer est l’auteur de: Afin que l’Afrique noire aille mieux publié chez Nouvelles éditions ivoiriennes; Géomorphologie, principes, méthodes et pratique publié chez Guérin éditeur; auteur principal du dictionnaire des termes géographiques contemporains publié chez Guérin éditeur. Avec François-Xavier Ribordy, il a co-édité La nature et la loi, publié par les Presses de l’Université Laurentienne. Il a publié plusieurs articles scientifiques dans les revues spécialisées.
Résumé de la communication :
La géographie post-moderne victime des dérives des géographes
Qu'advient-il de la géographie? Telle est la question au centre du colloque. Elle soulève la nécessité de réflexion sur l'existence même de la discipline au moment où on signale l'absence de la géographie et des géographes là où autrefois se vulgarisait et se défendait les doctrines et applications de la discipline. Rechercher des éléments de réponse à l'interrogation au centre de la présente rencontre interpelle géographes et amis de la géographie, car la discipline et ses pratiquants se trouvent à un moment crucial du développement de la pensée géographique et des structures académiques qui la véhiculent. Dans l'espace culturel francophone, ces structures portent toutes la marque de l'école française de géographie formée sous l'impulsion de Paul Vidal de la Blache entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Cette marque n'a pas résisté à l'influence des recherches anglo-américaines bien financées, dans le contexte d'une géographie post-moderne de plus en plus cloisonnée et mue par la méthode scientifique et par l'analyse critique. La grande diversité des approches et le traitement des thématiques qui sont d'actualité donnent à penser à un renouveau de la discipline. Il n'en est rien, car les faits sur le terrain prouvent le contraire. |
| |
|

M. Yaïves FERLAND, M.Sc.
Professionnel de recherche et chargé de cours au département d'histoire de l'Université Laval |
Notice biographique :
M. Yaïves Ferland a gradué à l’Université Laval ( B.Sc.App., 1993; M.Sc., 1997) en Géomatique (cartographie et gestion foncière), formation menant à la profession d’arpenteur-géomètre. Pendant une quinzaine d’années auparavant, il fut un organisateur communautaire et coopératif en rénovation urbaine dans le centre-ville de Québec, surtout dans les domaines du travail, de l’habitation locative et de la consommation.
Depuis, il a développé son expertise professionnelle par divers travaux en droit foncier et en urbanisme, en cartographie et cadastre, en géographie urbaine et structurale, ainsi qu’en toponymie et limologie, habituellement du point de vue sémiologique et de la représentation.
Il fut co-auteur d’un livre sur les fondements des pouvoirs municipaux en aménagement et urbanisme (1995) alors qu’il entreprenait des études doctorales en géographie cognitive à l’Université McGill. Il fit partie de la délégation canadienne au Groupe d’experts des Nations-Unies sur les noms géographiques (GENUNG) et en particulier de ses groupes de travail sur les exonymes et sur les bases de données toponymiques.
Il a été chercheur scientifique à l’agence de R&D pour la Défense du Canada (RDDC – Valcartier), dans la section de la Gestion de l’information et de la connaissance pour le commandement et contrôle, s’occupant entre autres de représentation et transfert intergéné-rationnel des connaissances, de cartographie organisationnelle et de géographie militaire.
Il est actuellement professionnel de recherche et chargé de cours (en ligne) au département d’histoire (archivistique) de l’Université Laval.
Résumé de la présentation :
La carte est le territoire du géographe
Où vont les géographies? Partout, justement! L’on peut prétendre que la géographie est la philosophie de l’espace dans sa complexité, posant la question fondamentale du « où » de toute chose, de tout être animé et de leurs rapports. On ne peut se surprendre (et encore moins se désoler) qu’elle se présente au monde (de l’enseignement et du travail) sous des atours fragmentés, métaphoriques ou utilitaires, camouflée sous d’autres noms ou ceux de certains domaines ou sujets: aménagement, climat, démographie, environnement, mondialisation, transports, tourisme, urbanisme… La géographie elle-même ne se prive pas d’emprunter tout: idées, données, matériaux, méthodes, pratiques, théories, vocabulaire. De plus, elle se (dis)qualifie au lieu de se nommer, n’étant plus une référence éclairante mais au mieux une facette réfléchissante parmi d’autres. La géographie est partout, mais a-t-elle une présence et une influence significatives, pas seulement contextuelles, sur ceux qu’elle rejoint?
À quoi sert le géographe? Plus qu’à faire voir, le géographe doit faire comprendre l’espace, donc en donner des représentations transférables, assimilables, engageantes, utiles. Partant de formes littéraires ou paramétriques, les représentations géographiques devraient aussi toujours être cartographiques, ce qui lui est unique et privilégié. Les règles de composition et de sémiologie sont telles que les cartes, faites à la main ou extraites de bases de données, offrent une richesse d’information structurée inégalable. Or tant de géographes les traitent comme des images.jpg piquées sur l’Internet, moins bonnes qu’un jeu vidéo 3D, invoquant (avec raison) les cartes de presse et de publicité désolantes, les cartes touristiques si jolies, les cartes routières trop précises et compliquées. Il y a tant à faire pour que la carte serve encore d’instrument de réflexion, d’analyse, de compréhension et de diffusion. La carte, objet sublime, est le véritable véhicule du géographe sur son territoire. |
| |
|

Professeur Gilles FUMEY
IUFM de Paris,
Université de Paris-Sorbonne |
Notice biographique :
Originaire des plateaux du Haut-Doubs jurassien, Gilles Fumey a fait ses études à Besançon dont il a étudié le paysage urbain chez Stendhal et Balzac dans son mémoire de maîtrise. Après l’agrégation et une thèse consacrée au concept de paysage, il est professeur en classes préparatoires aux grandes écoles à Lyon, puis à Paris. Inspecteur pédagogique d’histoire et géographie pendant une année (2001), il opte ensuite pour la recherche et est élu à l’université Paris-Sorbonne où il soutient une habilitation à diriger des recherches sur la géographie de l’alimentation. Il crée et dirige le master Alimentation & cultures alimentaires à l’université Paris-IV qui développe des recherches dans une abondante bibliographie – dont plusieurs ouvrages – sur les cultures alimentaires du monde, dans une optique résolument interdisicplinaire.
Il est le fondateur des Cafés géographiques, dont un site internet conserve la mémoire. Depuis 2007, il dirige la revue La Géographie qui se veut un pont entre le grand public et les chercheurs. A l’Institut universitaire de formation des maîtres de l’académie de Paris, il encadre d’autres projets visant à décloisonner la géographie et en pérenniser la diffusion par l’école.
Résumé de la présentation :
Trop de géographie tuerait-il la géographie ?
Comme on l’a dit du XXe siècle qu’il fut le siècle de l’Histoire, pourrait-on avancer que celui qui s’ouvre pourrait être celui de la géographie ? C’est possible.
Et pourtant, le reformatage de notre perception du monde par les nouvelles technologies pourrait tout aussi bien engloutir la géographie, si nous ne prenions pas le souci de la rajeunir. Comme toutes les disciplines, la géographie eut ses heures de gloire au moment des expansions coloniales européennes. Et si la redéfinition des Etats au cours du XIXe siècle a promu la géopolitique, incontestablement, la mondialisation du XXe siècle a brouillé les cartes, promouvant tout à la fois le Monde comme espace-en-soi et le local comme référent identitaire. Les systèmes de reconnaissance de géolocalisation permettent une connaissance très fine des territoires et, en même temps, privilégient très peu les analyses globales dont nous avons pourtant cruellement besoin.
Ainsi, géographes, nous serions devenus impuissants à produire la géographie que nos contemporains attendent : un nouveau raisonnement adapté à nos mobilités croissantes. Et une connaissance qui soit réellement interculturelle et non plus formatée sur le seul regard occidental. Nos chantiers de géographes sont vastes : aller à la rencontre de publics qui souhaitent comprendre l’espace comme un opérateur de leurs pratiques humaines ; et construire un discours de sens adapté aux questions que se pose l’humanité actuelle. Faute de quoi, la géographie connaîtra une éclipse comme elle en connut dans le passé au moment où l’humanité n’a jamais eu autant besoin d’elle. |
| |
|

Mme Hélène Grandbois, avocate.
Professionnelle de recherche,
Université de Montréal |
Notice biographique :
Pendant les 25 dernières années les expériences professionnelles et militantes d’Hélène Grandbois se sont principalement déroulées dans le milieu communautaire des droits et de l’alternative en santé mentale au Québec. Elle a su maintenir pendant tout ce temps des liens solides avec les groupes Nord-Américains.
Dans les années 80, ses activités sont liées à la sensibilisation par la participation à des films et vidéos et en tant que porte-parole d’Auto-Psy Montréal. Elle fait un baccalauréat en Sciences juridiques à l’UQAM et obtient son droit de pratique en 1995. Depuis 1988, Hélène Grandbois s’implique dans différents comités du Regroupement des Ressources alternatives en santé mentale du Québec RASMQ (sevrage, L’Entonnoir et femmes).
Depuis 1988, elle milite sur la question des électrochocs. Avec le temps et la recherche, sa position sur les électrochocs se radicalise. Elle milite pour leur abolition avec le Comité Pare-chocs depuis 2005.
Au milieu des années 90, elle participe à la critique du projet de loi modifiant la Loi sur la protection du malade mental à l’AGIDD-SMQ. Elle présente deux mémoires en commission parlementaire. Elle travaille comme agente de suivi communautaire pour Relax Action et rédige avec les membres de la ressource le code d’éthique de l’organisme. Elle participe activement à l’aspect culturel du congrès d’orientation de 1998 du RRASMQ à Québec par le soutien à la production d’œuvres collectives et la rédaction d’un texte sur l’impact de l’inceste (Aimer à en perdre la raison).
De 1994 à 2001, elle travaille à différents projets de recherche à l’École de service social pour David Cohen et Lourdes Rodriguez Del Barrio. Elle pratique le droit en bureau privé dans le domaine de la santé mentale de 1999-2002.
Depuis 2008, elle est salariée à titre d’agente de recherche à l’École de service social de l’Université de Montréal pour l’ARUCI.
- Le mouvement des personnes utilisatrices en Amérique du Nord.
- Recensement des écrits critiques sur le suivi communautaire, PACT
- Recensement des écrits et résumé d’articles sur la participation des personnes tant individuelle que collective.
À l’automne 2010, elle coordonne avec Lourdes Rodriguez un programme de formation des futurs travailleurs sociaux dans le cadre du cours de Madame Célia Rojas-Viger à l’École de service social.
La pérennité de son engagement en santé mentale lui donne une vision globale des enjeux et du chemin qu’il reste à parcourir. Ses intérêts se portent actuellement sur l’apport de l’expression artistique et de la spiritualité dans la reconstruction de l’Être. Sa pratique des arts visuels et de la littérature traversent toute cette période. |
| |
|
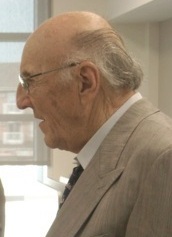
M. Marc-Aimé GUÉRIN, géographe
Président du Groupe Guérin |
À VENIR |
| |
|

Mme Alléluya GUSENGA
Maison de la géographie de Montréal |
À VENIR |
| |
|

Professeure émérite Colette JOURDAIN-ANNEQUIN
Université de Grenoble II |
À VENIR |
| |
|

M. Lambert J. LAKI-LAKA
Cofondateur et coprésident des Villages Mwana, Congo |
À VENIR |
| |
|

M. Jules LAMARRE, PhD.
Maison de la géographie de Montréal |
Notice biographique
Jules Lamarre possède une baccalauréat spécialisé en sciences économiques et une maîtrise en géographie (urbaine) de l'Université Laval. En 1990, il a obtenu un doctorat (Ph.D.) de l'Université McGill pour une thèse intitulée Des écoles à rendre communautaires. Il a enseigné la géographie sociale et culturelle comme chargé de cours durant une douzaine d'années, principalement à l'Université du Québec à Rimouski, à l'Université Concordia (Montréal), ainsi qu'au Cégep F.-X. Garneau de Québec. Il a aussi été chercheur invité ainsi que chercheur associé à l'INRS Culture et société. Parallèlement, il a toujours investit ses temps libres comme organisateur politique. Et quand il y avait des trous dans la succession de ses petits contrats de surnuméraire à temps partiel, alors il a été travailleur d'hôpital, ce qui lui a permis occasionnellement de moins mal vivre.
Pendant quatre ans, il a coordonné la Cellule Asie du Sud-Est, au département de géographie de l'Université Laval, et ses deux principaux projets de recherche Le défi forestier au Vietnam (CRDI) et Localized Poverty Reduction in Vietnam (ACDI). Enfin, il a été adjoint à la rédaction à la revue Les Cahiers de géographie du Québec.
En 2004, Jules Lamarre a cofondé les Cafés géographiques de Québec avant de cofonder, en 2008, ceux de Montréal avec sa collègue Édith Mukakayumba. Les cafés géographiques de Montréal ont ensuite servi de véhicule tout-terrain en territoire montréalais pour aller à la rencontre de communautés qui se méfient des représentants du milieu universitaire. Il est coordonnateur de la Maison de la géographie de Montréal, un organisme qu'il a également cofondé avec Édith Mukakayumba. |
| |
|

M. Neptune LEFRANC LEFAITE, étudiant de maîtrise
Sciences économiques,
Université de Sherbrooke |
À VENIR |
| |
|

Professeur Bertrand LEMARTINEL, Docteur d'État
Ex-membre du Conseil du comité national de géographie, Université de Perpignan, France |
Notice biographique
Bertrand Lemartinel, ancien élève de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud et agrégé de géographie, a été onze ans durant professeur en collège, avant de rejoindre l’enseignement supérieur. Il est d’abord spécialiste de Géographie Physique, puisqu’il a réalisé un Doctorat d’État traitant de l’histoire des formes d’une montagne ibérique. Mais ses fonctions professorales à l’Université de Perpignan Via Domitia le conduisent aussi à enseigner la géographie régionale de l’Amérique et en particulier du Canada. C’est donc peu dire qu’il est convaincu de la nécessité pour les géographes de maîtriser – au-delà des besoins techniques de spécialisation – des champs scientifiques et territoriaux les plus ouverts possible. Il assuré des fonctions de codirection ou de rédaction de deux revues géographiques et assure la relecture de nombreux articles dans plusieurs d’entre elles. C’est sans doute ce qui l’a fait choisir – après avoir siégé dans différents conseils scientifiques, notamment ceux du Groupe Français de Géomorphologie et de l’Association de géographes Français – comme expert, puis chargé de mission par la Mission Scientifique et Technique du Ministère de l’Enseignement supérieur. Il a aussi tiré une expérience forte de la gestion administrative, et donc des querelles universitaires, des années où il a assuré la charge de Doyen de sa Faculté. Tout cela l’a conduit, avec Louis Marrou, à la tête de la direction scientifique du Festival International de Géographie de Saint-Dié des Vosges, qui est certainement une des plus grandes manifestations de ce type existant au monde. Tous les deux souhaitent faire vivre la Géographie dans le cœur du public et lui prouver le caractère totalement indispensable d’une discipline sans laquelle ce même monde est incompréhensible.
Résumé de la communicarion :
La crise ? Quelle crise ? Ou… comment recoller les morceaux de la géographie française.
Si l’on en juge aux publications françaises ou aux émissions télévisées qui invitent à la découverte de notre Terre, la Géographie française ne devrait pas subir la crise que nous lui connaissons. Pourtant elle souffre depuis 40 ans d’une relative désaffection, tout en restant enseignée, ce qui lui confère une position plutôt moins défavorable que dans d’autres pays. Une des raisons principales est l’éclatement du corpus universitaire pour des raisons idéologiques plus que scientifiques. Les divisions, surtout après 1968, entre familles politiques ont conduit les géographes à s’entre-affronter, parfois en utilisant les catégories disciplinaires « classiques » : ainsi, la géographie physique, moins préoccupée de problèmes sociaux, a volontiers été jugée « réactionnaire ». S’il y a eu réaction de cette dernière, c’est pour affirmer son caractère réellement scientifique et rejeter les flottements épistémologiques de la géographie humaine. Cette fragmentation s’est poursuivie avec la mise en place d’une thèse brève, propice à des études parcellaires et d’autant plus détachées du réel que les financements se sont raréfiés. Le résultat le plus clair est le désintérêt pour les synthèses régionales qui permettaient pourtant de répondre aux grandes questions du moment. L’onde de choc s’est propagée dans tout le système d’enseignement, et les sciences voisines se sont empressées d’occuper les terrains ainsi délaissés.
Le Festival International de Géographie qui a – dans l’optique de Christian Pierret, son président-fondateur – remis les grandes interrogations du moment, n’a pas échappé totalement aux querelles du cénacle. Mais la nécessité de s’adresser à un public large, totalement indifférent aux guerres picrocholines des hommes de métier, a obligé ces derniers a reconsidérer leurs géographies pour dire en quoi la Géographie, non seulement était porteuse de sens pour comprendre les grands enjeux du moment, mais permettait – au travers de concepts d’aménagement – de proposer des solutions aux difficultés de notre temps. Recoller les morceaux, tel est l’objectif majeur à atteindre. |
| |
|

Professeure Elisabeth LEVAC, Ph.D.
Université Bishop |
À VENIR |
| |
|

Professeur Louis MARROU, Ph.D.
Directeur scientifique du FIG, Université de La Rochelle, France |
Notice biographique :
Directeur Scientifique du FIG en étroite collaboration avec B.
Lemartinel. Géographe ayant eu son premier poste de maitre de conférences dans une université en gestation : il s'agit de l'université de La Rochelle dont la date de création est 1993. Il y enseigne toujours et y observe donc aussi l'évolution de la géographie sur un territoire anciennement vierge de formation universitaire.
|
| |
|

Professeur Guy MERCIER, Ph. D.
Directeur du département de géographie de l'Université Laval |
Résumé de la présentation :
Geography is alive and well alive in the Province of Quebec
L’auteur se livre à une défense et illustration de la géographie québécoise. Il sera d’abord démontré que la formation géographique, à tous les niveaux d’enseignement, est meilleure que jamais. Malgré les difficultés qui subsistent ou qui viennent de surgir, il faut en effet se féliciter de la rupture récente d’importants verrous qui empêchaient l’épanouissement de la discipline. Il sera ensuite expliqué pourquoi, malgré l’alarmisme orgueilleux de quelques Cassandres, la géographie québécoise, sans renoncer à ses obligations scientifiques et à son rôle critique, est plus que jamais utile à la société. |
| |
|

Professeure Luisa Elena MOLINA, Ph.D.
Ex-directruce du département de géographie, Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela |
À VENIR |
| |
|
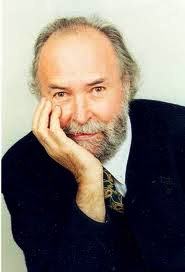
Professeur Christian MORISSONNEAU, Ph.D.
Université du Québec à Trois-Rivières |
Notice biographique :
Christian Morissonneau a étudié en histoire, géographie, et sociologie à l'Université Laval et à l'Université Mc Gill.
Il est titulaire d’un doctorat en géographie historique de l'université de Paris-Sorbonne. Il a enseigné et a été chercheur au Centre d'Études nordiques à l’Université Laval. Il enseigne au Département des Sciences humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Depuis plus de vingt ans, Christian Morissonneau a été actif dans différents organismes voués au développement régional, au tourisme, à la culture, au patrimoine et à l’aménagement fluvial dans Lanaudière et ailleurs : Conseil régional de Développement, Conseil régional de la Culture, Commission de toponymie du Québec, Corporation de l’aménagement de la rivière L’Assomption (Bassin Versant), Comité Zone d’Intervention prioritaire (Stratégie Saint-Laurent), administrateur à l’Association touristique régionale (un des rédacteurs du guide touristique annuel).
Il a été également conseiller municipal durant deux mandats à Saint-Zénon, en Matawinie. Administrateur au Comité national de mise en valeur du Chemin du Roy de Québec à Montréal. Membre de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Il est actuellement ambassadeur du Comité de Concertation et de Valorisation du Bassin Versant de la rivière Richelieu.
Résumé de la communication :
La question régionale
L'inquiétante absence des régions dans l'enseignement de la géographie.
On peut se questionner sur la régionalisation au Québec, ses étapes planifiées, ses finalités, la situation actuelle. L'État a réussi, à partir des années 1960, la distribution équitable des services publics, par la décentralisation, dans tout le territoire, de l'Abitibi-Témiscamingue à la Gaspésie; des organismes para-publics ont été répartis régionalement. On peut aussi questionner l'enseignement qui n'a pas suivi le phénomène et qui ignore dans le dit « Univers social» de l'enseignement secondaire , non seulement les régions mais le territoire québécois comme objet d'étude.
J'entends par région toute portion d'espace découpée selon un point de vue
(végétation, climat, activités dominantes, etc) et bien sûr les régions administratives découpées par l'État. Il est surprenant que les régions soient ignorées alors que le programme de géographie du Secondaire vise à donner une «compétence» désignée comme: «Lire l'organisation d'un territoire».
À l'Université, les départements de géographie et d'histoire n'ont pas institutionnalisé l'enseignement des régions. Pourtant le Québec, c'est aussi les régions du Québec. Ces territoires sont significatifs pour les ressources, pour l'habitat, les activités économiques et culturelles et les phénomènes socio-démographiques. Leur connaissance contribue au sentiment d'appartenance local, régional et national, et peut préparer à la praxis. |
| |
|

Mme Édith MUKAKAYUMBA, Ph.D.
Présidente, Maison de la géographie de Montréal |
Notice biographique :
Edith Mukakayumba est détentrice d’un baccalauréat en géographie de l’Université nationale du Rwanda et d’une maitrise et d’un doctorat en géographie de l’Université Laval. Première rwandaise à être investie du titre de Ph.D. et première Africaine noire à enseigner, à titre de professeure, dans une université québécoise, Édith Mukakayumba mène depuis une trentaine d’années une carrière en dents de scie : d’universitaire, de consultante en coopération internationale et en développement international et d’activiste qui milite en faveur de l’empowerment des groupes défavorisés.
Elle a enseigné la géographie dans plusieurs universités du Québec à titre de chargée de cours (UQAR, UQAC, UQAM), de professeur substitut (UQAC), de professeure invitée (UQAC). Elle a aussi enseigné et fait des recherches dans d’autres domaines que la géographie, notamment au département de sociologie de l’UQAM, où elle a donné un cours d’anthropologie de la condition des femmes, et au département de psychologie de l’Université McGill, où elle a participé, pendant sept ans, aux travaux du Groupe de recherche sur les relations intergroupes et les Peuples autochtones. Elle a enfin participé à l’encadrement des étudiants, tant comme responsable de travaux de fin d’études de premier cycle ou comme co-directrice de recherche d’un mémoire de maitrise que comme membre de comités d’évaluation des mémoires de maitrise et des thèses de doctorat, dont deux jury de soutenance de thèse.
Très engagée dans ses milieux de vie, elle a été membre de plusieurs comités de travail et conseils d’administration dont, notamment, le Conseil d’administration de l’Université Laval, le Comité scientifique de l’ACFAS, le Comité consultatif sur les relations interethniques et interraciales de la Communauté urbaine de Montréal, l’Office des consultations publiques de la ville de Montréal, le Réseau québécois des chercheuses féministes, le Comité québécois femmes et développement, le Comité canadien de préparation de la conférence de Beijing, le Comité montréalais de préparation de la marche mondiale des femmes en 2000. Elle a cofondé plusieurs organismes dédiés à la promotion des groupes défavorisés, ainsi qu’à l’information et à la formation des citoyens : le Réseau des chercheuses africaines de la Diaspora, Force leadership africain, Yes we can canada, La Maison de la géographie de Montréal. En attendant l’employeur qui consentira à lui offrir les conditions de travail propices à la production, à la transmission et à la diffusion des connaissances grâce à l’exploitation optimale de son capital de compétences, elle s’investi pleinement dans la lutte pour la survie et pour la reconnaissance à leur juste valeur, des personnes des plus démunies de notre société, notamment des Africaines et des Africains de la diaspora, et, plus spécialement, des rescapés des guerres, des massacres de masse et des génocides. Pour ce faire, elle travaille avec son partenaire, Jules Lamarre, à l’organisation des débats sous forme des cafés géographiques, à l’organisation des conférences et des colloques dans les congrès scientifiques comme l’ACFAS, à la publication des articles dans les médias et dans les ouvrages collectifs,… Ces activités, dont la principale finalité est l’information et la formation du public, sont devenues des lieux de rencontre et de mobilisation collective des acteurs sociaux d’origines diverses, ayant en commun la lutte contre l’exclusion et l’appauvrissement, donc aussi, naturellement, des terrains d’étude sur les problématiques relatives à cette lutte.
La poursuite de ses recherches sur le terrain de l’action, où Edith Mukakayumba est impliquée comme actrice et analyste, ne cesse de révéler les secrets des mondes fascinants, empreints d’optimisme, d’espoir et de joie de vivre dont très peu de recherches rendent compte. L’un ces mondes, devenu son centre d’intérêt, est celui des territoires où des rescapés des guerres, des massacres de masse et des génocides travaillent à la reconstruction de leurs identités et de leurs liens sociaux. Articulée, notamment, autour des lieux de culte et d’expression artistique, l’étude de ces territoires débouche sur la reconnaissance d’un nouveau champ de recherche, qui pourrait être désignée par l’expression de géographie de l’espoir, auquel Edith Mukakayumba et son collègue, Jules Lamarre, tentent d’attirer l’attention de la communauté scientifique.
|
| |
|

M. François MUNYABAGISHA
Président, Amitiés Canada-Rwanda |
À VENIR |
| |
|

Mme Monique NADEAU-SAUMIER, Ph.D.
Institut de recherche en art canadien Gail et Stephen A. Jarislowsky, Université Concordia |
Notice biographique :
Monique Nadeau-Saumier est détentrice d'un doctorat en histoire de l’art de l’UQÀM. Sa thèse « Un espace et un lieu de culture, le Art Building de Sherbrooke, 1887-1927 » a été publiée en version abrégée, aux Éditions GGC, en 2008.
Elle a enseigné l'histoire de l'art et la muséologie à l'Université Bishop's, tout en assumant le poste de directrice administrative du Centre de recherche des Cantons de l'Est à la même université de 1987 à 1995. Elle a contribué plusieurs articles à la Revue d’études des Cantons de l’Est / Journal of Eastern Townships Studies, publiée par le CRCE.
Membre associée de l’Institut de recherche en art canadien Gail et Stephen A. Jarislowsky, à l’Université Concordia, elle y poursuit présentement sa recherche sur la vie et l’œuvre du peintre canadien Louis Muhlstock (1904-2001).
Résumé de la communication :
L'art, l'histoire, l'architecture et les paysages, tous ces éléments témoignent aujourd'hui des vagues successives d'immigration qui ont façonné les Cantons-de-l’Est. Les Américains d’abord, puis les ressortissants des Îles britanniques, et enfin, les Canadiens français, ont légué à cette région unique les composantes historiques et culturelles que l’on retrouve dans le patrimoine bâti et l’aménagement du territoire. Chez nous, cette mémoire a été sauvegardée par les sociétés d’histoire, par les nombreux musées, sites patrimoniaux et centres d’interprétation, par les circuits et activités culturelles, et par les institutions de haut-savoir. Monique Nadeau-Saumier, Ph. D., historienne de l'art, de l'architecture et muséologue, a choisi de présenter le patrimoine bâti dans la MRC de Magog, en particulier celui de la région de Stanstead, véritable microcosme où l’on retrouve les caractéristiques architecturales qui ont inspiré la nouvelle route touristique et culturelle : Le Chemin des Cantons / Townships Trail. |
| |
|

Professeur Francis LELO NZUZI, Ph.D.
Université de Kinshasa, Congo |
À VENIR |
| |
|
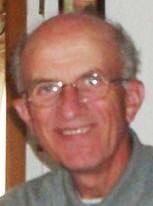
M. Edmond PAULY, M.A.
Retraité de l'enseignement au niveau secondaire
Maison de la géofraphie de Montréal
|
Résumé de la communication :
Place des cours de géographie dans les écoles secondaires du Québec depuis 1967
En me basant sur mon expérience dans 3 écoles secondaires du secteur public dans l'Ouest de Montréal, les cours de géographie ont subi 3 vagues à l'intérieur des sciences humaines .
La vague de la géographie de 1967 à 1981 s'explique par le caractère optionnel des 3 cours de sciences humaines durant le deuxième cycle des écoles secondaires alors que le cours de géographie et d'histoire demeuraient obligatoires au premier cycle. Les cours optionnels en sciences humaines au deuxième cycle (4e et 5e secondaire) portaient les noms suivants :histoire contemporaine, géographie des Grandes Puissances, géographie physique et humaine, et vie économique. La géographie était choisie par un plus grand nombre d'élèves que l'histoire et la Vie Économique.
La vague de l'économie a débuté en septembre 1982 avec la nouvelle réforme en éducation basée sur des programmes modulaires définis par des objectifs généraux et intermédiaires, et mesurés par des tests formatifs et sommatifs. La nouvelle grille-horaire au niveau secondaire contenait 2 cours obligatoires en géographie (1ère et 3e secondaire) , 2 cours obligatoires en histoire (2e et 4e secondaire) et un cours obligatoire en Éducation économique (5e secondaire).
La vague de l'histoire a débuté avec la nouvelle réforme en Éducation en 1999 basée sur les compétences transversales. Le cours d'histoire est obligatoire dans chacun des 5 niveaux de l'école secondaire. En première et deuxième secondaire, la géographie est un cours obligatoire à côté de l'histoire. Au deuxième cycle, un seul cours optionnel de géographie du Monde Contemporain est offert en 5e secondaire.
L'avenir idéal des Sciences Humaines au Québec est de rétablir une harmonisation entre les 3 disciplines dans la formation de base des jeunes de 8 à 18 ans. Pourquoi faut-il ajouter
la géographie dans le 2e cycle? Comment y parvenir? |
| |
|

M. Benoît ROY
Président, Rassemblement pour un pays souverain et éditeur de La Presse québécoise |
À VENIR |
| |
|

Professeure Manon SAVARD, Ph.D.
Directrice du module de géographie, Université du Québec à Rimouski |
Notice biographique :
Manon Savard est professeure en géographie humaine de l’environnement à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) depuis janvier 2005. Géographe et archéologue, elle détient un baccalauréat et une maîtrise en géographie de l’Université du Québec à Montréal, un D.E.A en Environnement et Archéologie de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et un doctorat en archéologie de l’Université de Cambridge. Elle dirige le module de géographie de l’UQAR.
Ses recherches actuelles portent sur 2 axes: 1) Les relations Homme-milieu, notamment l’impact des changements environnementaux sur les sociétés humaines et, inversement, les impacts humains sur le milieu naturel. 2) L'archéologie de l'Est-du-Québec, notamment l'archéologie citoyenne, le rôle des ressources culturelles et patrimoniales dans le développement et le dynamisme des « régions-ressources ».
Résumé de la communication :
La réforme de l’enseignement de la géographie et le clivage géographie humaine - géographie physique
La géographie humaine et la géographie physique sont plus que jamais réunies autour de concepts et d’objets unificateurs comme les risques, la géodiversité et la gestion intégrée du erritoire. En voulant catégoriser la géographie, tantôt comme une science humaine ou sociale, tantôt comme une science (naturelle), on limite sa portée.
Au Québec, l’enseignement de la géographie au secondaire relève du domaine d’apprentissage « Univers social ». Avec la réforme de l’enseignement, on a accentué le clivage géographie physique- géographie humaine en réduisant le nombre d’heures d’enseignement consacré à la géographie et en optant pour une définition qui mise sur l’espace social. Des éléments de géographie physique sont maintenant relégués au domaine d’apprentissage « Mathématique, Science et Technologie » sous d’autres étiquettes, dont celle de l’environnement. Qu’adviendra-t-il de la géographie si son enseignement diverge de ses applications actuelles et des besoins de la société ? |
| |
|

Professeur émérite Dietrich SOYEZ
Université de Cologne, Vice-président, Union géographique internationale |
À VENIR |
| |
|
.jpg)
M. Sereyrath SRIN, M.A.
Directeur, Maison de l'interculturel de Saguenay |
À VENIR |
| |
|

Mme Espérancia TCHISS-LOE-PEMBETH
Présidente, Les Amis du Congo et d'ailleurs |
À VENIR |
| |
|

Mme Diane UMUTONI, étudiante de maîtrise
Sciences économiques, Université de Sherbrooke |
À VENIR |
| |
|

Professeur Christian VANDERMOTTEN
Université Libre de Bruxelles
Président du Comité National et de la Société royale belges de géographie |
Notice biographique :
Christian VANDERMOTTEN est docteur en sciences géographiques et licencié en urbanisme. Il est professeur ordinaire émérite à l'Université Libre de Bruxelles, où il enseigne la géographie économique et politique. Il a dirigé la réalisation du volume « Géographie politique » de la nouvelle édition de l'Atlas national de Belgique et est co-auteur du volume « Géographie écoonmique ». Il est l'auteur de « Territorialités et politique », un traité de géographie politique et de géopolitique, ainsi que de l'ouvrage « La production des espaces économiques ». Il travaille aussi dans les domaines de la géographie urbaine et de l'aménagement du territoire. De manière générale, ses travaux portent sur Bruxelles, la Wallonie et l'Europe, dans une perspective macrogéographique, qui accorde une large place à la formation des structures spatiales. Il est président de la Société Royale Belge de Géographie et membre de la Classe des Lettres de l’Académie Royale de Belgique. Il a été président d'EUGEO, l'association des sociétés européennes de géographie.
|
| |
|

Professeure émérite Yvette VEYRET, Docteure d'État
Université de Paris X
Ex-présidente du Comité National de Géographie de France |
Notice biographique :
Yvette VEYRET a été élève-maître à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Privas (Ardèche), puis élève professeur en géographie à l’Université de Grenoble. Elle a obtenu le CAPES, puis l’Agrégation de géographie. Elle a ensuite été nommée Assistante à l’Université de Clermont Ferrand. Sa recherche a été consacrée pendant neuf ans aux paléoenvironnements et aux régions englacées au Quaternaire (Massif central français). Elle a soutenu sa thèse de doctorat d’Etat en 1978, cette thèse de géomorphologie a été effectuée sous la direction du professeur A. GODARD (Université Paris 1). Elle a poursuivi une recherche sur les héritages quaternaires au Canada (Québec-Labrador- et Nouvelle Ecosse), en Cornouaille anglaise et en Ecosse.
Devenu professeur des Universités en 1979, elle a été nommée d’abord à Clermont Ferrand puis à Paris 7 Jussieu en 1985. Sa recherche a été conduite au laboratoire de l’Ecole Normale supérieure, sur le thème de l’érosion des sols dans les régions de grande culture, puis sur les risques et la vulnérabilité et sur le développement durable. Cette recherche a été poursuivie au laboratoire de géographie de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense qu’elle a rejoint en 2000.
Yvette VEYRET a participé à plusieurs groupes de réflexions sur la géographie et son enseignement dans l’enseignement secondaire notamment. Elle a été entre 1994 et 2002 membre du Conseil national des programmes, représentante de la géographie, responsable des programmes du secondaire. Elle continue à travailler avec l’Inspection générale de géographie dans le cadre de très nombreuses formations de formateurs
Elle a été membre du jury des concours de recrutement du secondaire : CAPES, Agrégation.
Elle a été vice- présidente puis présidente du Comité national français de géographie, elle est actuellement membre du conseil du CNFG. Elle participe à un groupe de travail international qui prépare le congrès de l’UGI à Cologne en 2012. Depuis plusieurs années elle participe activement au festival international de géographie où avec l’Inspection générale elle a contribué à créer un « forum du développement durable » particulièrement destiné aux enseignants du secondaire. Elle collabore à de nombreuses revues et a publié une centaine d’articles scientifiques et une quinzaine d’ouvrages (seule ou en collaboration)
Elle a créé depuis trois ans, une Université à la campagne qui fait intervenir des géographes pour le grand public dans un village de Provence.
Résumé de la communication :
La géographie française, atouts et limites d’une discipline
La géographie est enseignée en association avec l’histoire, à tous les niveaux d’enseignement. Elle est présente dans les concours de recrutement des professeurs (CAPES, Agrégation), dans les concours de certaines grandes écoles de commerce, d’agronomie…
La géographie a subi des mutations considérables dans les années 1980. D’une géographie physique (géomorphologie surtout) encore largement dominante, elle est devenue une science sociale au sein de laquelle s’inscrit une géographie de l’environnement. Cette mutation qui ne s’est pas faite sans crise, explique peut-être la place actuelle de la discipline.
La géographie universitaire est présente dans de nombreuses universités françaises. On peut considérer que dans les années à venir, elle subira des mutations importantes, par des regroupements, des spécialisations dans quelques grands pôles de recherche, sans pour autant que son contenu, sa spécificité soient mis en question.
Chaque année, sont produites de nombreuses thèses (sources CNU). C’est là encore l’indication d’un dynamisme de la discipline. Comment expliquer cette situation ? Plusieurs facteurs peuvent être soulignés :
- le recentrage : la géographie, une science sociale (qui traite de la ville, des campagnes…) qui intègre les aspects physiques, environnementaux, le développement durable et les questions d’aménagement des territoires
- les métiers auxquels la géographie conduit : ingénieurs territoriaux, métiers liés à l’urbanisme, à la gestion des risques, à l’environnement…ainsi que les métiers d’enseignants chercheurs et d’enseignants du secondaire
- le maintien voire l’affirmation de la géographie dans l’enseignement secondaire et l’association avec l’histoire
- l’importance d’associations qui se mobilisent pour défendre la géographie quand cela est nécessaire, CNFG, l’APHG, Société de géographie…
Pourtant des inquiétudes subsistent :
Elles sont liées paradoxalement à la pluridisciplinarité ou la transdisciplinarités de plus en plus nécessaires qui peuvent porter en germe un risque de dilution de la discipline. Dans certains cursus la géographie n’apparaît plus en tant que telle, et cela au profit « d’études urbaines », « rurales » ou « environnementales »…
La géographie ne peut exister que si elle définit bien sa spécificité, notamment par rapport à la sociologie, à l’économie, aux sciences de la nature.
Il est en outre indispensable que les géographes se fassent connaître, qu’ils publient y compris pour le grand public afin de montrer ce que notre discipline apporte à la société. Cette ouverture vers le grand public, les médias est encore à développer en France même si le FIG constitue une formidable tribune. |
| |
|

M. Éric WADDELL, Ph.D
Chercheur associé au CIÉRA, Université Laval, et professeur honoraire, École de géosciences, Université de Sydney, Australie |
À VENIR |
| |
|

Mme Cheryl WALKER
Cofondatrice et coprésidente des Villages Mwana, Congo |
À VENIR |
| |
|

Mme Connie WYATT-ANDERSON
Présidente, Conseil canadien de l'enseignement de la géographie |
Notice biographique :
Connie Wyatt Anderson has been teaching high school social sciences — including grades 10 and 12 geography — on the Opaskwayak Cree Nation, a progressive First Nations community adjacent to The Pas, Manitoba, since 1992. She has been involved in the creation of student learning materials and curricula and has contributed to a number of textbooks, teacher’s support guides, and school publications. She has written educative materials for several non-profit groups and recently co-authored the Grade 11 History text used in Manitoba schools. She also served as a Teacher Leader for the Library of Parliament from 2006-2009, and is currently working with the Treaty Relations Commission of Manitoba as a curriculum advisor and writer for a province-wide treaty education initiative.
Connie sat on the Canadian Council for Geographic Education as representative for Manitoba, Saskatchewan, and Nunavut from 2006-2009 and assumed the role as Chair in 2010. She has been actively involved in the creation and coordinating of the CCGE’s flagship lesson plans, which are made available to teachers across the country.
|
| |
|
|
|